50 ans d’éducation
Article paru dans EPFL Magazine 26
Par Laureline Duvillard et Anne-Muriel Brouet
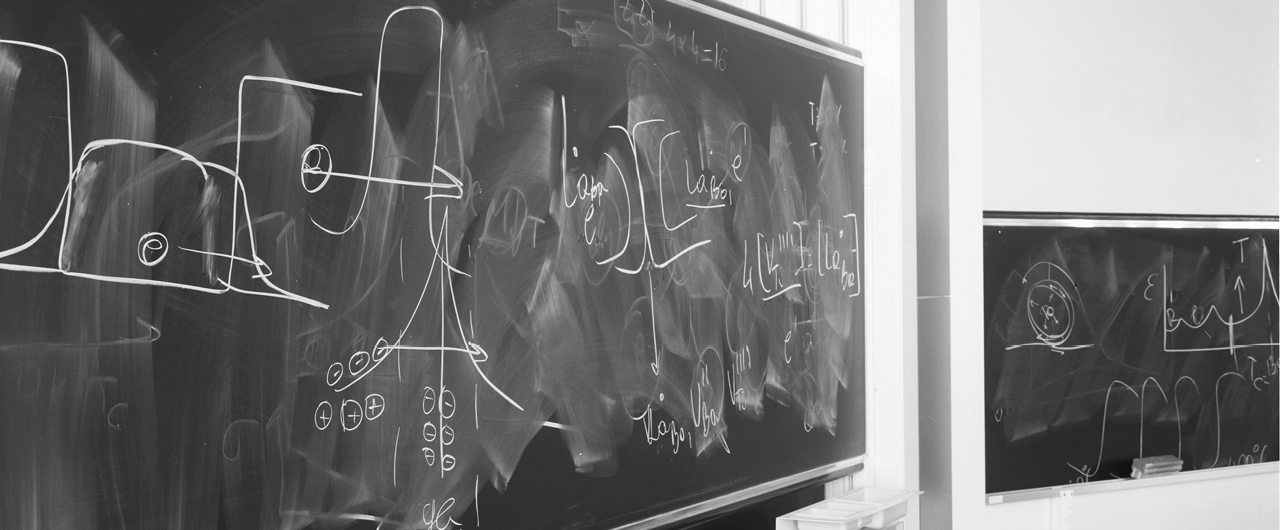
L’EPFL est une audacieuse quinqua qui n’a pas peur de se remettre en question et de jouer un rôle de pionnière. En vue de la Journée de l’éducation qui se tiendra le 17 mai, tour d’horizon des défis en matière de formation et des moyens pour y répondre.
La vidéo accompagne les bouquins, les cours se suivent parfois à la maison et quelques clics sur un smartphone peuvent enclencher une expérience à distance.
Mais la craie, le tableau noir, les livres et les auditoires sont toujours là. En 50 ans, l’enseignement à l’EPFL a changé un peu sur la forme, beaucoup sur le fond, pas tellement sur la manière. Comment former au mieux les plus de 11’000 étudiants qui ont choisi notre campus, capter leur l’attention et les équiper de compétences pour affronter les problèmes d’avenir? Le point avec différents acteurs qui planchent sur ce casse-tête défiant tout algorithme.
«Les défis pour la formation à l’EPFL sont de deux types, logistique et pédagogique, souligne Pierre Vandergheynst, vice-président pour l’éducation. Du point de vue logistique, l’Ecole attire toujours plus d’étudiants. On s’en réjouit, mais se pose la question de faire au mieux notre travail d’enseignant tout en continuant à accueillir d’excellents élèves. Du point de vue pédagogique, notre enseignement doit refléter le fait que les problèmes se complexifient et deviennent plus interdisciplinaires. Nos étudiants doivent faire preuve de créativité, d’esprit d’innovation et être capables de travailler avec des gens de divers profils.»
Interdisciplinarité et expérimentation
Pour répondre à ces défis, l’EPFL a synchronisé les grands cours polytechniques et allégé le curriculum de propédeutique afin que les étudiants se concentrent sur les fondamentaux. Mais elle a aussi créé le fonds MAKE pour soutenir financièrement des projets interdisciplinaires étudiants, tels EPFLoop, et elle a mis en place de nouvelles infrastructures via le Discovery Learning Program.
Un programme favorisant des travaux pratiques innovants et l’apprentissage par projets. Ceci en offrant aux enseignants et aux étudiants des laboratoires équipés de matériel de pointe (Discovery Learning Labs) qui facilitent l’interdisciplinarité, un soutien professionnel et des espaces de prototypage pour la concrétisation des projets. «Notre but est de proposer une approche ouverte, permettre aux étudiants d’apprendre en expérimentant. Nous sommes là pour faciliter la mise en œuvre des bonnes pratiques d’enseignement», note Pascal Vuilliomenet, responsable des DLL.
Ces bonnes pratiques, quelles sont-elles? A l’EPFL, c’est essentiellement le Centre d’appui à l’enseignement (CAPE) et le centre LEARN, inauguré en automne dernier, qui se penchent sur cette question. Le premier via les évaluations et le coaching des enseignants, le second en faisant de la recherche translationnelle en sciences de l’éducation. «Notre mission est de nous nourrir du réel pour la recherche et de nourrir le réel par la recherche», note Francesco Mondada, directeur académique du centre LEARN.
Des réformes outillées
Le centre LEARN a pour objectif de mettre à profit de tous les échelons du système éducatif suisse les connaissances acquises. A ce titre, il a formé durant quatre journées 350 enseignantes vaudoises de 10 établissements pilotes en vue de l’introduction de la science informatique au cycle 1 (4-7 ans). «Les personnes sont arrivées à la formation plutôt dubitatives, mais elles ont vu que nous proposions une approche débranchée de la science informatique, ce qui les a convaincues de l’importance d’enseigner aux enfants les bases de la pensée computationnelle, relève Jessica Dehler Zufferey, directrice opérationnelle du centre LEARN. Les jeunes baignent dans un monde numérique, mais pour en devenir un acteur, il faut le comprendre.»
Côté EPFL, le centre LEARN vise surtout à accompagner l’innovation pédagogique, en fournissant aux enseignants qui se lancent dans de nouveaux projets l’appui nécessaire pour développer une approche scientifique sur leur pratique. «Notre rôle est d’encourager les enseignants à faire de la recherche sur leur manière d’enseigner, car ce n’est pas vraiment connu, ni cultivé et encadré. Nous voulons aller vers des réformes plus outillées, en travaillant en partenariat avec l’enseignant porteur d’un projet novateur et le Centre d’appui à l’enseignement pour l’aspect pédagogique», explique Francesco Mondada.
Actuellement, le centre LEARN se penche sur les bénéfices pour les étudiants du cours d’algèbre linéaire en classe inversée mis en place par Simone Deparis à la rentrée 2017. Ceci afin de voir si ce format est réellement profitable aux étudiants et de le populariser le cas échéant. Car toute réforme n’est pas bonne à prendre, les innovations n’aboutissant pas toujours au résultat escompté. «Depuis six ans, beaucoup de gens s’interrogent sur les MOOCS en se demandant si c’est une bonne manière d’enseigner à grande échelle, exemplifie Pierre Vandergheynst. On voit qu’il y a un très fort taux d’échec dans ces cours, car les personnes ne les suivent pas jusqu’à la fin. A l’EPFL, on les utilise donc plus comme une version moderne du livre. Cela montre qu’on doit toujours s’interroger sur différentes façons de faire pour discerner la meilleure pratique et ne pas avoir peur de répondre que c’est celle en vigueur.»
Encourager les compétences transversales
Se pose ensuite la question de l’enseignant, la meilleure des pratiques ne valant rien dénuée de pédagogie. «Un bon enseignant s’adapte à la classe et au type d’enseignement. Il remet en question son enseignement et n’arrête jamais de faire évoluer son cours», estime Nicolò Ferrari, président de la Commission des étudiants représentants des sections et coordinateur de l’AGEPolytique. Cet élève en deuxième année de Bachelor en physique se réjouit du fait que depuis l’automne 2018 la commission de nomination des nouveaux professeurs de l’EPFL intègre un étudiant. Par contre, il souhaiterait que les évaluations des enseignants prennent plus d’importance. «On remarque qu’un grand accent est mis sur la pédagogie en première année, après cela a tendance à s’effriter. D’autre part, lorsque les évaluations sont négatives de manière répétée, il faudrait mettre en place des actions concrètes. On voit dans certains cas que les personnes sont seulement déplacées dans une autre section, et le problème persiste.»
Le Centre d’appui à l’enseignement s’attelle justement à revoir les évaluations des enseignants afin qu’elles soient plus détaillées et leur permettent d’avoir un retour plus étoffé sur leur pratique. «Qu’est-ce qui fait un bon prof? Aujourd’hui, l’EPFL ne propose pas de critères, c’est pourquoi sur la base de la littérature scientifique existante, nous sommes en train d’en établir. Ceci dans le but de guider les enseignants vers les meilleures pratiques pour améliorer leur enseignement, comme l’échange avec les pairs ou la recherche sur leurs pratiques tel que le promeut le centre LEARN», explique Roland Tormey, coordinateur du CAPE.
En parallèle, le centre planche sur la manière dont les enseignants peuvent évaluer les élèves. «En partenariat avec les membres d’Eurotech et l’Université de technologie de Tallinn, nous développons des outils pour évaluer les compétences transversales, relève Roland Tormey. Car la créativité, les compétences sociales, la capacité à se confronter à des problèmes ouverts en travaillant en équipe vont prendre toujours plus d’importance pour nos étudiants. Et pour les encourager, il faut changer la manière d’évaluer, mettre l’accent sur le processus au lieu du résultat.»
Faire éclater la barrière du temps
Reste l’épineux problème du temps. Pour les enseignants, comme pour les étudiants, il n’est pas toujours évident de dégager une place pour faire fructifier ces compétences transversales et apprendre en mettant la main à la pâte. « l faut un espace dans le curriculum où les étudiants travaillent sur des sujets ouverts avec beaucoup de coaching. Cet espace doit être flexible, modulaire et apte à accueillir des projets de différentes formes. Pour cela, nous devons repenser les plans d’études de la fin du Bachelor», explique Pierre Vandergheynst.
Le vice-président pour l’éducation souhaiterait aller encore plus loin et «faire sauter l’échelle du temps passé à l’université». Soit créer les conditions cadres pour que les personnes ayant fait leurs études à l’EPFL puissent y revenir toute leur vie afin d’actualiser leurs connaissances. «L’université doit apprendre les fondamentaux, car ces bases seront utiles aux étudiants toute leur vie, par contre, avec les nouvelles technologies, les spécificités liées à un domaine sont très vite redéfinies. C’est pourquoi il faut un diplôme amendable tout au long de la vie. A mon sens, c’est le défi qui attend le système de formation universitaire ces 20 prochaines années dans le monde entier. Et nous pouvons jouer un rôle de pionnier.»
Le lancement du Certificate of Open Studies (COS) marque déjà un premier pas dans ce sens. Ce nouveau type de diplôme, délivré par l’EPFL pour la première fois en 2018 et unique en Suisse, certifie des programmes de formation continue accessibles à des personnes sans titre universitaire. «Notre point fort est notre manque d’histoire, de traditions. Nous avons un esprit novateur qu’il faut veiller à conserver, nous nous remettons sans arrêt en question, nous n’hésitons pas à nous lancer dans de nouvelles aventures. Nous sommes une jeune école et nous avons un rôle à jouer, car les solutions viennent toujours des jeunes», conclut Pierre Vandergheynst. A 50 ans, l’EPFL a aiguisé sa réputation internationale, pris du poids, mais pas de mauvais pli. Son esprit conserve la fougue de la jeunesse, toujours prêt à repousser les frontières de l’impossible.